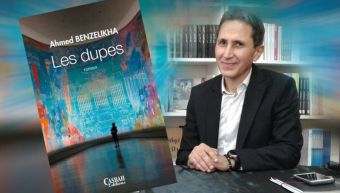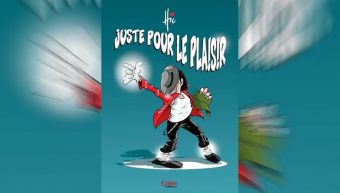Aujourd’hui, le contexte est différent et l’Exécutif actuel veillera à ce que les biens publics donnent l’exemple en ce qui concerne l’utilisation de l’énergie solaire.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a demandé au gouvernement, lors de la réunion du Conseil des ministres, tenue dimanche 21 novembre, “d’obliger toutes les communes du pays à utiliser l’énergie solaire dans l’éclairage public, y compris au niveau des voies express et des zones montagneuses à l’instar des Aurès, de l’Ouarsenis et du Djurdjura”.
De même, il lui a ordonné de “fixer un délai ne dépassant pas trois mois pour la transition énergétique par le recours à l’énergie solaire dans certains établissements et structures de l’État, notamment les secteurs de la santé et de l’éducation”. Le chef de l’État a, également, mis l’accent sur la nécessité de “coopérer avec les pays développés dans les recherches sur les techniques de généralisation de l’utilisation des énergies renouvelables”.
En 2018, l’Exécutif de l’époque avait établi un programme consistant à “intégrer” les énergies renouvelables dans le domaine des biens communaux, et ce, en alimentant 1 541 écoles primaires en électricité d’origine solaire, soit une moyenne d’une école primaire par commune à l’horizon 2020.
L’initiative a, cependant, tourné court. Aujourd’hui, le contexte est différent et l’Exécutif actuel veillera à ce que les biens publics donnent l’exemple en ce qui concerne l’utilisation de l’énergie solaire.
Pour beaucoup d’observateurs, le gouvernement a, ce faisant, opté pour une approche de bon sens. Mais sont les conditions requises pour que cette approche soit mise en œuvre avec succès ? La mise en place de financements pour des projets d’énergie solaire constitue l’une des principales conditions préalables.
Pour autant, l’État va-t-il mettre la main au portefeuille pour soutenir de tels projets dans un délai aussi serré (3 mois) ? Des spécialistes reconnus sont enclins à penser que l’État devrait se montrer plus généreux avec la politique de transition énergétique, en la plaçant au premier plan de ses priorités à financer.
En tout cas, le gouvernement est appelé à joindre l’action à la parole et à rétablir la confiance dans ce secteur, d’autant que la politique suivie jusqu’ici, en matière d’énergie renouvelable, a complètement échoué et que le doute s’est installé. Pourtant, les projets inscrits dans cette politique sont séduisants sur le papier. Face à des enjeux de sécurité énergétiques sérieux, le gouvernement actuel semble, néanmoins, avoir pris la mesure de l’urgence dans le renouvelable.
Il s’est engagé, dans son plan d’action, à opérer une transition progressive vers les énergies propres, estimant que la dimension relative à la transition énergétique vers les énergies nouvelles et renouvelables vise à atteindre la croissance verte par le recours aux technologies énergétiques innovantes et digitalisées.
Et qu’elle a, également, comme objectif de mettre en place une nouvelle architecture de développement où la rente aux énergies fossiles laisse place à des modèles pérennes qui valorisent le lien social et les emplois durables, tout en favorisant une meilleure qualité de vie et la résilience aux différentes crises et risques majeurs.
Le premier défi à relever dans l’immédiat consiste à lancer l’appel d’offres relatif à la réalisation d’installations photovoltaïques d’une puissance de 1 000 mégawatts, avant fin 2021. Donc, ce projet photovoltaïque, annoncé fin 2020, est à présent entré dans son ultime phase. Il fait partie d’un programme de développement des énergies renouvelables, dont l’objectif à terme vise à installer 15 000 MW d’ici à 2035.
Au départ, il était question de lancer cet appel d’offres en juin dernier et de mettre en service ces installations fin 2021. Le calendrier proposé semble être très serré. Et le pari difficile à relever, sachant que le financement du projet n’est pas encore assuré.
Youcef SALAMI