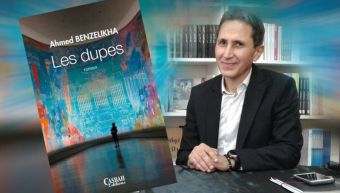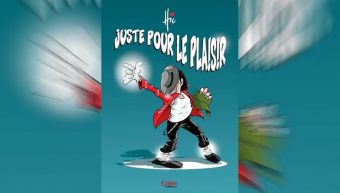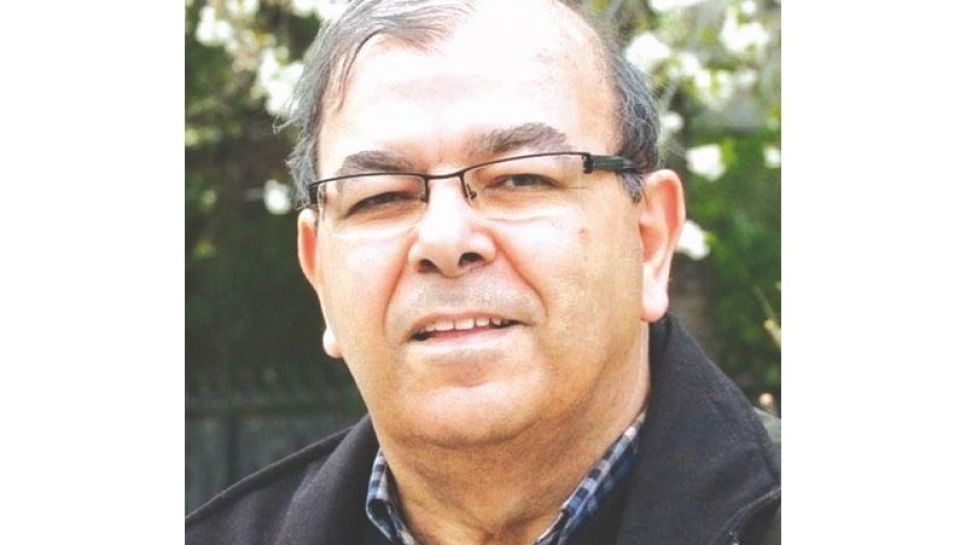
En retrait de la vie politique, Abdesselam Ali-Rachedi continue de scruter les événements qui agitent le pays avec un regard sévèrement critique, à raison. En expliquant l’impasse algérienne, il préconise de sortir de “la légitimité populiste en changeant de paradigme”. Cela passe par changer “la manière de penser la réalité algérienne”. Plus qu’un réformateur, Abdesselam Ali-Rachedi décline, dans cette interview, une approche qui peut sembler radicale, mais sans doute nécessaire pour refonder le pays. “Pour jeter les bases d’une nouvelle Algérie, il est impératif de sortir du populisme islamo-nationaliste. D’abord neutraliser les relais idéologiques du populisme : dissoudre le FLN et toutes ses organisations satellites, dissoudre les partis islamistes et même tous les partis pour leur permettre de se refonder sur de nouvelles bases. Il faut aussi supprimer les ministères des Moudjahidine et des Affaires religieuses et soustraire la télévision et la radio à l’emprise de l’État”, propose celui qui fut ministre des Universités, puis cadre dirigeant du FFS, avant de lancer Essabil, un parti interdit.
Liberté : Deux ans après le Hirak, quel regard portez-vous sur la situation du pays ?
Abdesselam Ali-Rachedi : Clairement, le pays est dans une impasse multidimensionnelle. En 2013 déjà, donc bien avant l’effondrement des cours du pétrole, j’avais tiré la sonnette d’alarme sur l’impasse budgétaire qui se profilait à l’horizon et prédit la fonte puis l’épuisement du Fonds de régulation des recettes. Depuis, on n’a fait que faire tourner la planche à billets, aggravant ainsi la situation par une fuite en avant porteuse de tous les périls.
Mais le déficit budgétaire n’est pas fondamentalement dû à l’insuffisance des ressources générées par une économie peu performante : c’est une question éminemment politique. C’est l’illégitimité du pouvoir qui en est la cause principale. N’étant pas légitime, le pouvoir est contraint d’acheter la paix sociale pour se prémunir d’une révolte populaire. Cette politique a un coût qui peut être supporté quand la manne pétrolière est généreuse, mais qui devient vite intenable si le baril ne tient pas ses promesses. Par le biais de la loi de finances pour 2022, le pouvoir tente de se débarrasser du boulet des transferts sociaux et du soutien des prix de première nécessité. Mais il n’est pas sûr qu’il le fasse réellement, à moins qu’il ne se sente suffisamment fort pour affronter la colère de la rue. L’impasse est aussi économique.
Quelle est la nature de cette économie ?
Notre pays vit dans une économie de rente qui consiste à consommer et à gaspiller une ressource naturelle non renouvelable et non dans une économie productive qui crée des richesses par le travail. Outre le non-sens économique, la rente est aussi source de corruption et de gabegie. L’État monopolise la rente et soumet à sa logique tant les entreprises publiques que les entreprises privées. Mais il y a aussi une rente symbolique : celle conférée par le nationalisme – souvent confondu avec le patriotisme – et la participation, réelle ou prétendue, à la Guerre de Libération nationale. En définitive, c’est le discours national-populiste ou son avatar le discours islamo-populiste qui servent de légitimité factice, en l’absence de légitimité démocratique réelle. C’est pourquoi il n’y a pas d’autre moyen de sortir de l’impasse qu’en changeant de paradigme : sortir de la légitimité populiste pour aller vers une légitimité démocratique. Faute de l’avoir compris, le Hirak était condamné, dès le départ, à l’impuissance. Car le changement ne signifie pas seulement changement des hommes et des institutions, mais bel et bien un changement de paradigme, autrement dit un changement de la manière de penser la réalité algérienne.
Ce mouvement citoyen inédit n’a pas trouvé de prolongement politique. Au-delà de l’obstacle que constitue le pouvoir pour le changement, quelle est la part de responsabilité des partis politiques ?
Mouvement citoyen, oui et non. Des foules en mouvement ne signifient pas forcément mouvement citoyen. Tant qu’on est dans le populisme, c’est-à-dire le peuple pris comme une totalité indivisible, on ne peut parler de citoyens et de mouvement citoyen. Le citoyen est d’abord un individu singulier, conscient de ses droits et de ses devoirs. C’est lui qui doit être considéré comme acteur, car dans la réalité le peuple n’existe pas. Il n’existe que des individus – “on peut serrer la main d’un individu, on ne peut pas serrer la main du peuple”.
La notion de peuple est une construction idéologique. Le populisme est cette idéologie dans laquelle le peuple joue un rôle central. À l’indépendance, dès le départ, l’Algérie a été enfermée dans le discours populiste – “un seul héros, le peuple”. Ce discours a été un héritage du mouvement national. Mais il a surtout servi à poser les fondements de l’autoritarisme, avec en toile de fond un socialisme d’État prétendument au service des masses populaires. Quand, après les événements d’Octobre, le national-populisme s’est trouvé affaibli, le pouvoir s’est ouvert à l’islamo-populisme, avec lequel il partage la même vision populiste.
Tout le monde parle de changement, mais quel contenu faut-il lui donner ?
Le changement est absolument nécessaire, mais il ne se résume certainement pas à juste changer de pouvoir. L’enjeu est considérable car il faut préalablement sortir du populisme, ce qui est loin d’être une mince affaire et demande du temps.
Quant aux partis politiques, ils n’ont de parti que le nom. À un moment donné, on a cru que le système avait concédé une ouverture démocratique et accepté le multipartisme. Dans les faits, on a eu droit à une multitude de partis uniques. Ils étaient une copie conforme du parti unique. La raison ? Le populisme, idéologie commune à la plupart de ces partis. Même ceux dits de la mouvance démocratique ne font qu’amalgamer des thèmes démocratiques à un fond largement populiste.
À quoi est due cette incapacité des partis à proposer des projets politiques mobilisateurs ?
Le rôle des partis politiques est, en théorie, de capter les attentes émanant de la société, par définition très diverses, de les traduire en projets politiques de droite, de gauche ou du centre et d’en faire des programmes à mettre en œuvre par les élus. Or, aucun parti politique algérien ne se dit de droite, de gauche ou du centre. Ils s’adressent tous au “peuple” dans sa totalité, chacun rivalisant avec l’autre d’être le vrai porte-parole du peuple. C’est le propre du populisme que de rejeter les élites et toute idée de représentation. Très souvent, il y a un chef charismatique (zaïm) qui se voit paré de toutes les vertus et qui incarnerait la totalité du peuple. Nul besoin dans ce cas de partis ou d’élections. Le rôle des partis est alors le soutien au pouvoir en place, dans l’espoir de glaner une petite portion de la rente. En résumé, tant que nous ne sommes pas sortis du populisme, il ne peut y avoir de partis au sens propre du terme. Il ne peut y avoir que des mouvements dont la finalité est la mobilisation du peuple au profit de l’État, c’est-à-dire, en pratique, le pouvoir en place. C’est ce qui explique aussi que la plupart des partis se sont transformés en appareils où les luttes internes ont pris le dessus sur le militantisme.
Peut-on parler d'une fin de cycle de la classe politique dans sa configuration actuelle ?
Il n’y a jamais eu à proprement parler de classe politique. L’existence de cette dernière est subordonnée à la sortie du populisme, sous ses deux aspects, nationaliste et islamiste. Il ne peut y avoir de changement en perspective sans aller jusqu’à un changement de paradigme. Abdelmadjid Tebboune qui, pourtant, n’a pas participé à la Guerre de Libération nationale tente vainement de s’accrocher à la légitimité nationaliste et son Algérie nouvelle ressemble fort à l’ancienne.
Pour jeter les bases d’une nouvelle Algérie, il est impératif de sortir du populisme islamo-nationaliste. D’abord, neutraliser les relais idéologiques du populisme : dissoudre le FLN et toutes ses organisations satellites, dissoudre les partis islamistes et même tous les partis pour leur permettre de se refonder sur les nouvelles bases. Il faut aussi supprimer les ministères des Moudjahidine et des Affaires religieuse et soustraire la télévision et la radio à l’emprise de l’État. Bien d’autres mesures pourraient être ajoutées pour le court terme. Sur le moyen et le long termes, ce sont les réformes de l’éducation et de la justice qui devraient être mises en œuvre pour les mettre en conformité avec le nouveau paradigme.
Entretien réalisé par : Karim Benameur