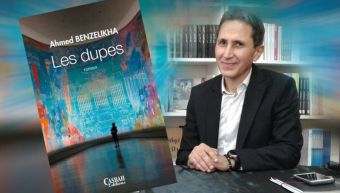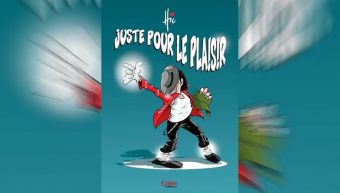Dix ans après, la guerre a ruiné les aspirations de la jeunesse et engendré la pire tragédie humanitaire au monde.
Au Yémen, les morts, les déplacés, les épidémies et la famine ont fait oublier les espoirs fugaces de la révolution de 2011. Dix ans après, la guerre a ruiné les aspirations de la jeunesse et engendré la pire tragédie humanitaire au monde. En pleine émergence du Printemps arabe, le 27 janvier 2011, des milliers de personnes manifestent à Sanaa pour demander le départ du président Ali Abdallah Saleh, au pouvoir depuis des décennies.
C'est le point culminant de la révolution yéménite, débutée dès la mi-janvier. L'onde de choc partie de Tunisie avait rapidement atteint le pays le plus pauvre de la péninsule Arabique. “Le peuple veut la chute du régime”, scandent à leur tour les Yéménites.
Ce slogan phare du Printemps arabe est alors dans toutes les bouches, après les 32 années cumulées de pouvoir du président Saleh, selon qui gouverner le Yémen était “plus difficile que danser sur des têtes de vipères”.
Les raisons de la colère ? “Les fractures de cinquante ans de sous-représentation politique, d'inégalités sociales, de pauvreté et de corruption, en plus des luttes identitaires”, explique à l'AFP Maged al-Madhaji, témoin de ce soulèvement et aujourd'hui directeur du Sanaa Center for Strategic Studies.
Dans un pays très pauvre, entouré de riches monarchies pétrolières, la révolte des Yéménites est d'abord imprégnée de spontanéité et de pacifisme, se rappelle un de ses chefs de file, Yasser al-Raïni. “La révolution a réuni sur les places publiques toutes les composantes de la société qui voulait se débarrasser de l'injustice et bâtir un nouveau Yémen”, raconte ce militant à l'AFP.
Dans un pays où presque tout le monde détient au moins une arme à feu, le mouvement, insiste Yasser al-Raïni, n'avait connu aucune violence avant l'intervention des forces de sécurité et des partisans du président.
Rebelles et coalition étrangère
Dix ans plus tard, le Yémen est plongé dans ce que l'ONU a qualifié de pire crise humanitaire au monde, avec des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et une population constamment au bord de la famine. Depuis 2014, un conflit dévastateur oppose les forces gouvernementales aux rebelles houthis, soutenus par l'Iran.
Une coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite intervient depuis 2015 pour appuyer le gouvernement, en exil après avoir été chassé de Sanaa, la capitale. Aujourd'hui, Maneï al-Matari, autre leader de la contestation, se souvient que “le pouvoir personnel du président Saleh et sa volonté de voir son fils (Ahmed, qui commandait la Garde républicaine) lui succéder avaient uni les Yéménites contre lui”.
Dès le 2 février, le président Saleh promet des réformes et de ne pas briguer un nouveau mandat en 2013, mais cela ne fait qu'enhardir la contestation. “Les jeunes révolutionnaires n'avaient aucune expérience politique. C'est là que les partis et ceux qui maîtrisent les outils de l'action politique sont entrés en jeu”, note Yasser al-Raïni.
L'opposition parlementaire se joint à la contestation, qui s'étend au nord, d'importantes tribus épousent la cause des manifestants et de nombreux députés du parti au pouvoir, le Congrès populaire général, démissionnent.
En février se met en place le sit-in de l'université de Sanaa, qui sera considéré comme l'épicentre de la révolution, à l'instar de la place Tahrir au Caire.
Dix ans, dix kilos
Le 18 mars, des partisans du président tirent sur les manifestants à Sanaa, faisant 52 morts. Quelques jours plus tard, l'un des principaux chefs de l'armée, Ali Mohsen al-Ahmar, fait défection et des dizaines d'officiers se rallient à la contestation. Les chefs politiques affirment progressivement leur emprise sur le mouvement pendant que les rebelles houthis cherchent à en tirer profit.
Grièvement blessé dans un attentat le 3 juin et soigné en Arabie Saoudite, le président Saleh finit par accepter fin 2011 de céder le pouvoir en vertu d'un plan de paix élaboré par les puissantes monarchies voisines. Il sera assassiné fin 2017 à Sanaa par les houthis, auxquels il avait fini par se rallier dans l'espoir de revenir aux affaires.
“Les gens voulaient seulement voir l'avènement d'un autre système. Mais la récupération de la révolte par les partis politiques l'a défigurée”, dit le chercheur Maged Al-Madhji. “Tout cela a préparé le terrain aux combats ultérieurs”, estime-t-il.
Ces dernières années, les photos de manifestants enthousiastes ont laissé place à celles d'enfants rachitiques affamés, à l'instar d'Ahmedia Abdou, qui vit avec sa famille dans un camp de déplacés à Hajjah (nord-ouest). Elle a dix ans et pèse dix kilos.
“Son père est mort il y a des années. Elle vit avec sa mère et son frère dans une maison en paille”, raconte à l'AFP l'un de ses proches. Ahmedia souffre de malnutrition sévère, explique-t-il, mais “l'hôpital ne reçoit pas d'enfants malnutris de plus de cinq ans”. Elle n'a “nulle part où aller”.
AFP